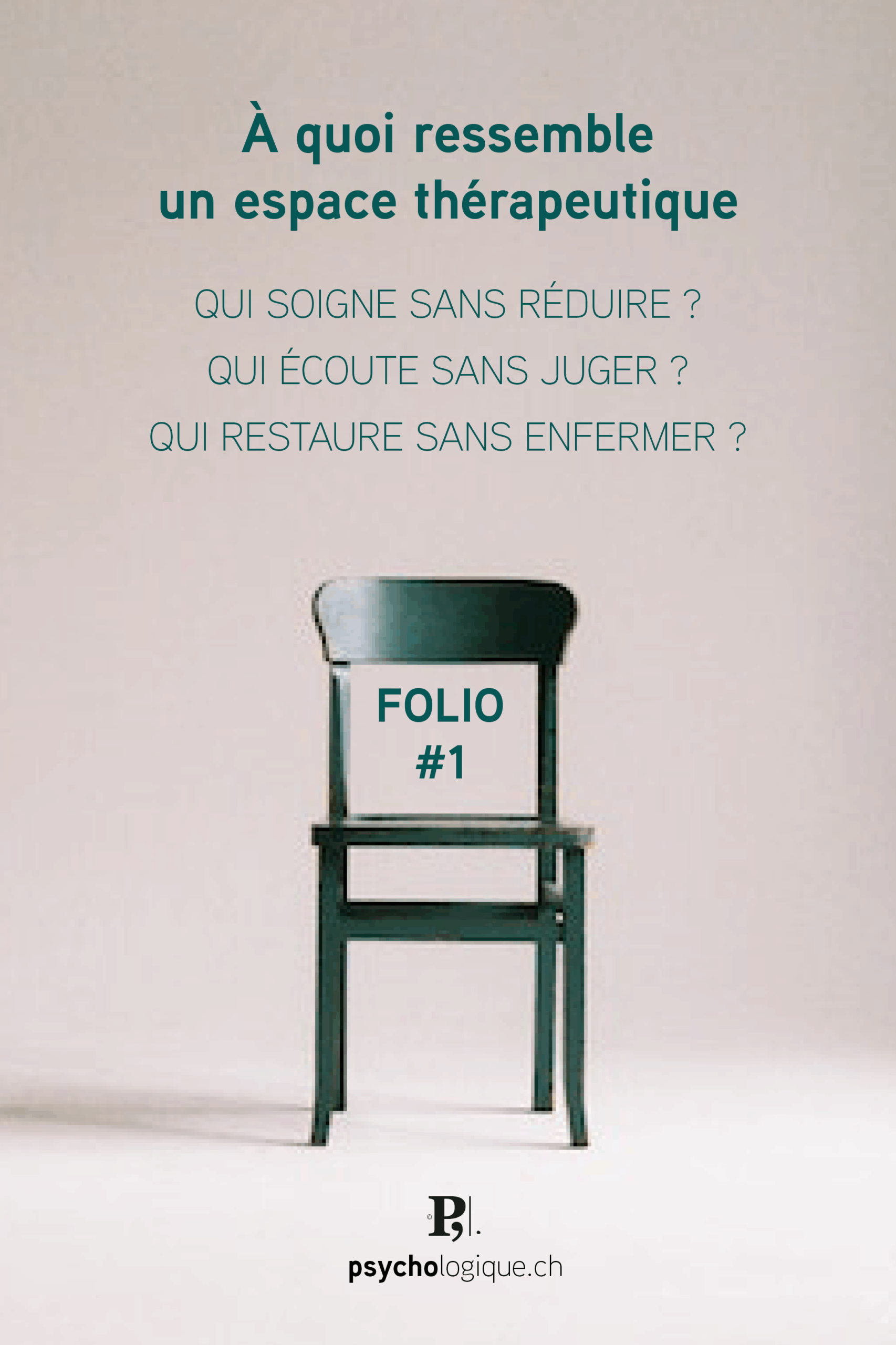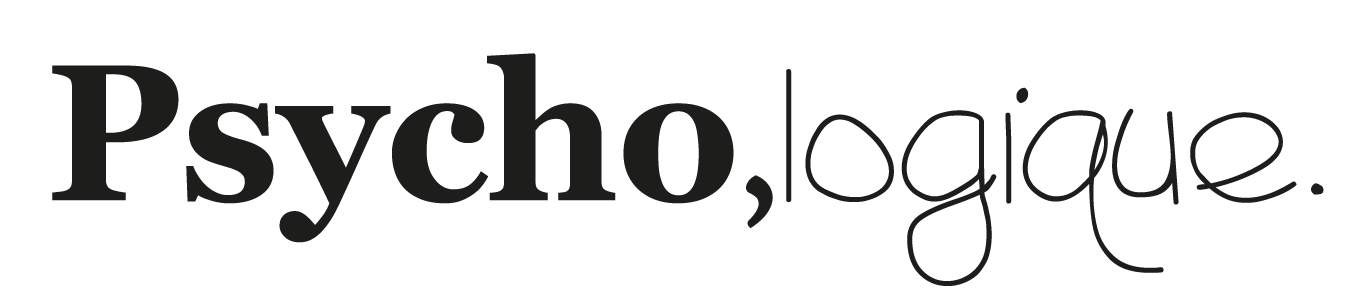FOLIO #1
⚖️ L’espace thérapeutique devrait être une balance en équilibre :
-
entre soin et pouvoir,
-
entre diagnostic et écoute,
-
entre individu et système.
Cet équilibre fragile appelle une véritable identification systémique : reconnaître que la souffrance ne se limite pas à un individu isolé, mais s’inscrit dans un contexte relationnel, familial et social.
Or, lorsque cet espace bascule du côté de la seule prescription ou du jugement rapide, la balance se dérègle. L’écoute disparaît, la parole du patient devient secondaire, et l’effet des psychotropes – dépendance, altération du vécu, isolement – prend le pas sur le soin véritable.
A QUOI RESSEMBLE
L’ESPACE THERAPEUTIQUE ?
QUESTIONS OUVERTES
-
Et si nous faisions de l’espace thérapeutique un lieu d’équilibre vivant, co-construit entre soignants, patients et familles : comment l’imaginer ensemble ?
-
À quoi ressemblerait un espace thérapeutique qui soigne sans réduire, qui écoute sans juger, qui restaure sans enfermer ?
-
Comment transformer nos pratiques pour que la balance thérapeutique penche durablement du côté de l’humain ?
-
Quelles expériences, quelles idées, quelles visions pourriez-vous partager pour nourrir cette réflexion collective ?
Réflexion sur le processus thérapeutique et sur les limites des soins psychiatriques dans la prise en charge dite d’urgence
Certaines expériences récentes que j’ai pu constaté et expérimenté dans le champ de la santé mentale mettent en lumière un paradoxe : le processus thérapeutique, essentiel pour accompagner la souffrance psychique, peut parfois montrer ses limites lorsque l’approche psychiatrique ou devrai-je dire le biais/ levier s’exerce sans considération suffisante pour la complexité relationnelle et familiale de l’individu qui appelle à l’aide.
Trois questions se posent alors avec acuité
-
-
Comment prévenir les situations où l’expertise médicale glisse vers un abus de pouvoir, volontaire ou non ?
-
Pourquoi la systémique familiale reste-t-elle si souvent négligée, alors qu’elle constitue une clé essentielle de compréhension et d’accompagnement ?
- Jusqu’où la psychiatrie peut-elle intervenir sans franchir la frontière de l’ingérence dans la vie privée ?
-
Il ne s’agit pas de remettre en cause la valeur et l’engagement des professionnels, mais d’ouvrir un espace de réflexion sur les pratiques et sur la place accordée aux patients dans leur parcours de soin.
Pourtant, certaines pratiques montrent leurs limites.
Une approche réellement thérapeutique et émancipatrice ne peut se construire que dans le dialogue, le respect mutuel et l’intégration des différentes dimensions de la vie humaine : individuelle, relationnelle, familiale et sociale.
Comment, collectivement, repenser les pratiques pour concilier expertise médicale, respect des personnes et reconnaissance de leur environnement relationnel ?
La thérapie prend tout son sens lorsqu’elle met l’écoute et la restauration de l’humain au cœur du soin et non pas par l’anéantissement des signaux de détresse par une prise en charge exécutive et souvent par la force avec l’administration de traitement médicamenteux qui empêchent tout discernement et éteint tout.
L’usage massif des médicaments, y compris en dehors des hospitalisations, questionne : répond-on vraiment à la souffrance, ou cherche-t-on surtout à la faire taire ?
Là où l’accompagnement devrait ouvrir à la parole, à la compréhension de la dimension familiale et relationnelle, on assiste parfois à une médicalisation qui occulte complètement la complexité de l’expérience humaine qui amène un sujet à demander de l’aide.
La chaise vide que j’ai choisie pour illustrer cette réalité devient alors un symbole fort : absence du droit à la parole du/de la patient-e, place non reconnue, dimension systémique négligée ou niée.
- Où se situe la vraie place du/ de la patient,-e lorsque le processus devient prioritairement logistique pour traiter l’urgence ? On se contente de déplacer le problème en tentant d’éteindre le feu momentanément avec une multitude de psychotrope et in fine, le/a patient-e sort de son hospitalisation avec son problème, voire une multitude d’autres problèmes qui tombent en cascade comme résultante de plusieurs semaines « loin du bal » au propre comme au figuré.
- Pourquoi la systémie familiale est-elle encore si souvent négligée, alors qu’elle constitue une clé essentielle pour comprendre et accompagner la souffrance psychique et l’expression traumatique présente ou passée ? Et alors qu’elle fait partie des programmes de formation (et de formation continue) de nombre de professionnels œuvrant dans le champ de la santé mentale ?
- N’est-il pas urgent de réinvestir l’espace thérapeutique comme lieu d’écoute, de reconnaissance, et non pas uniquement comme un champ d’actions prescriptives ?
- Comment reconnaître les potentielles dérives d’un système familial qui s’auto-puni et devient autoritaire à travers le regard clinique induit par les professionnels de la santé, au lieu d’être un refuge salutaire face au diagnostic ?
Une fois un diagnostic déterminé et la personne « étiquetée: schizophrène, borderline, suicidaire, bipolaire,… » le trouble psychique envahit le système familial, relationnel et devient insolvable autant pour la personne concernée que pour les autres membres de la famille ou les proches, les rendant impuissants, témoin silencieux, juges voir parfois même bourreaux et en corrélation, toutes et tous des victimes auto-proclamées ou du moins intrinsèquement liées.
Dans le dispositif actuel, j’ai pu constater à quel point la vie psychique effective de la personne est complètement occultée, l’affecte est même nié. La parole n’a pas sa place, le dialogue est orienté, les solutions tournées vers les médicaments avec ou sans consentement éclairé avec des mesures légales souvent drastiques du type PAFA sans aucune voie/voix d’expression clair, car pris sur le vif pour la personne concernée. Lorsque le pique est atteint, la sanction est proclamée. Pourtant, il y aura eu plusieurs signaux avant-coureurs et personne n’a été en mesure de les lire. Étonnant comme nous sommes capables de dénis sur nous-même et sur la réalité de celles et ceux qui nous entourent.
La place des uns en réponses au statut de l’autre.
Traiter l’urgence ce n’était, dans mon cas, pas prendre soin de ma personne puisque j’ai pu constater à quel point je suis devenue victime de ma propre blessure. Je suis passée d’un diagnostic d’épuisement émotionnel, Merci au Docteur qui a su lire dans ma blessure à celui de maniaco-dépressive avec de surcroit un besoin crucial d’être mise sous curatelle et certainement dans un avenir proche d’une mesure AI.
Durant mon séjour et les longues nuits d’insomnie ont émergé toutes sortes de questionnement, dont celles qui préfigurent dans cette lettre ouverte, car malgré mon état critique sous psychotropes, malgré mon parcours de combattante à tenir debout, à garder mon sang froid, j’ai vu et je me suis vue. Ce qui m’a poussé a avoir plus de discernement sur moi-même et sur les autres patient-e-s qui m’entouraient et menaient le même genre de combat avec leurs propres ressources.
A ce titre, plusieurs questions ont fleuri sur : la place que l’on a, sur celle que l’on prend et celle qu’on nous donne. Et la plus importante : quelle place peut-on prendre sans déranger notre famille, notre entourage, notre environnement professionnel ?
L’internement psychiatrique renferme, c’est une place de choix visiblement pas pour celles et ceux qui y sont conduit-es. Un dispositif pour caser les gens quand nous ne savons plus quoi en faire ou comment faire avec leur détresse.
Je pense souvent à cette jeune adulte qui n’a plus de contact avec ses parents et qui une fois « relâchée » finira dans un foyer d’accueil. Un foyer où, tout comme dans cette structure, la drogue ou devrai-je dire l’assistance médicalisée est omniprésente et où le dialogue est complètement absent.
Plus on tente d’exprimer quelque chose, plus on fait en sorte de nous faire taire. Je peux en témoigner aussi. J’ai eu droit à la camisole de force, me faisant retourner 40 ans en arrière si ce n’est pas plus, dans la cage au folle, et à repenser à ce fameux film, vol au-dessus d’un nid de coucou. Je vous rassure, c’est un hôpital ouvert, vous pouvez partir quand vous voulez. Pas vraiment.
A ce sujet, je vous conseille la lecture de l’article de la journaliste Malka Gouzer qui a investi la face cachée de notre institution pharmacologique, celle qui légifère en sous-marin pour éteindre l’humain dans son quotidien. Sa parole reflète étrangement mon vécu durant ces 22 jours sans n’avoir plus aucun droit sur ma vie, mes choix, mes pensées. Tout le personnel soignant savait mieux que moi ce qui était bon ou pas pour moi.
J’ai aussi repensé à nos aïeules, et son texte me fait froid dans le dos lorsqu’elle évoque le terme lobotomie, j’y ai pensé en permanence.
Tant de femmes ont été éteinte, parquée dans ces lieux de soins, avec cette étiquette de folle. Je vous renvoie également au livre d’Adèle Yon: Mon vrai nom est Élisabeth qui retrace le parcours d’une femme qui n’a plus jamais eu la voix au chapitre de sa vie et dont l’interview de l’autrice sur le site « Le Point » vous en donnera l’essence des grandes lignes d’une vie investies par la mane psychiatrique des années.
Les hommes ne sont pas en reste dans cette histoire. Ils sont tous des bourreaux, des criminels (violeurs, voleurs, alcooliques récidivites, immigrés instables), des hommes bourrus, perdus aussi et qui boivent pour oublier, incapables de gérer leurs émotions, qui prennent un peu trop la vie comme elle vient sans se poser de question sur les conséquences de leurs actes et de leur décompensation face au trop plein d’exigences. Ils reçoivent peu d’écoute. Normal, on ne leur accorde pas plus de crédit et on ne les invite pas non plus à en parler. L’homme est fort et il doit se taire pour ne pas faire de vague. S’il crie trop fort, on le canalise par les médicaments et on le pénalise avec la camisole.
Au coeur de cette équation, il y a, la communication, l’effet de la communication brut aussi, et celle qui est filtrée par un regard clinique, religieux, sociétal et qui explique tout et son contraire, sans prendre en compte la réalité systémique.
J’ai vu un père et une mère venir tous les jours rendre visite à leur fille, désespérés et tout tenter pour sortir cette jeune adulte de l’engrenage d’un système qui tuent à petit feu avec des mesures dites sous contraintes soi-disant pour son bien.
Une fille dont l’âme s’éteignait jour après jour, complètement « stone », assise à attendre que le temps passe. Privée de cafétéria et de toute activités proposées habituellement. Bouge pas, tu risques de mettre ta vie en danger.
J’ai aussi entendu un trentenaire qui ne souhaite plus vivre et qui parle de ça en permanence, alors qu’il est pris en charge depuis plus de 9 mois dans ce centre de soins psychiatriques.
J’ai vu des victimes de violences conjugales « purger leur peine » dans un système qui ne valorise pas leur place et qui sont surtout traitées à la place de « leur bourreau », avec la peur dans les tripes de perdre la garde de leur enfant, de tout perdre car leur divorce aura un impact considérable sur leur avenir tant financier que personnel.
J’ai vu une femme s’effondrer en pleurs devant moi après avoir reçu l’annonce de son diagnostic (sans considération et surtout sans retour) de bipolarité et dépendance affective et qui a vu tous ses projets de mariage (prévu quelques mois plus tard) et de nouvel emploi s’envoler définitivement alors qu’elle venait à l’origine pour se remettre d’un épuisement professionnel après avoir -ironiquement- travaillé pendant des années comme soignante dans les soins neurologiques à prendre en charge des patient-es qui présentaient le même type de troubles qu’on venait de lui diagnostiquer : « Madame, vous savez, c’est minimum deux ans et un traitement à vie pour ce genre de pathologie. ». « Bonne digestion », ai-je eu envie de dire. Voilà ce qu’on lui a servi peu avant 18:00, juste avant les 45 minutes (exécutoires,…) imparties pour le souper.
Et ce n’est là qu’une face de la médaille, l’autre n’étant pas plus reluisante.
Des aides-soignant-e-s dépassé-es, qui mangent froid et mal, comme nous. Ne dit-on pas qu’on mange en premier avec les yeux et que l’on est ce que l’on mange ?
Je ne l’espère pas car il est préférable de ne pas regarder ce que l’on sert à son prochain, et de ce fait en premier à soi.
J’ai aussi connu des femmes et de hommes qui (re)viennent dans l’établissement se faire soigner et qui deviennent comme des zombies, assommé-es par des médicaments, perdant leur dignité, leur libre arbitre et tout discernement. Iels ont mal au coeur, iels manquent de temps pour exprimer leur désarroi, n’ont aucun espace pour raconter leur histoire.
Pendant ces 22 jours, j’ai eu le temps de toutes et tous les écouter. C’est ironique, il faut être patient-e pour devenir patient-e et ainsi avoir le temps d’offrir ce temps d’écoute et permettre à l’autre cet espace bienveillant. Le patient devient aide-soignant ? Et alors, qui reste-t-il pour prendre en charge le ou la soignant-e qui passe sa journée de travail à courir après les gens au propre comme au figuré ?
Leur travail consiste principalement à canaliser les tempéraments fugitifs et fougueux et à administrer les médicaments. En synthèse voici les psychotropes les plus administrés (antidépresseurs, stimulants, anxiolytiques, somnifères souvent sous forme de cocktail) et ensuite à en faire les frais et au demeurant à prodiguer quelques soins et quelques minutes d’écoutes sociales.
Par contre, la prise de médicament n’est pas anodine, les réactions chimiques et neurologiques sont légions et s’expriment par différents biais (cris, colère, tristesse, mutisme, décompensation). En toile de fond, les effets les plus fréquents apparaissent : dépendance et difficulté de sevrage, altération de l’identité et du vécu émotionnel, fatigue et troubles du sommeil, fluctuations d’humeur, isolement relationnel, perte de motivation. Autant de manifestations qui rappellent que derrière la prescription se joue bien plus qu’un simple ajustement biologique : c’est l’équilibre d’une vie intérieure et relationnelle qui est en jeu.
Dans le contexte de patients internés en psychiatrie ou sous forte dépendance pharmacologique, quelle justice proposer ? Réparatrice ? Ou comme le questionne le psychologogue Julien Besse, devrait-on parlé de « Justice relationnelle et contextuelle « ? Pour voir et écouter sa vidéo sur le sujet, c’est par ici.
A la sortie d’un internement quelle thérapie – ou devrai-je dire quelle justice thérapeutique réellement réparatrice – est mise en place afin que les personnes face à leur traumatisme psychique, face à leur épuisement émotionnel, puissent in fine reprendre des forces, leur esprit et leur « fonction » dans un système complétement détruit ?
Offrir un espace de dialogue et d’écoute au sein duquel le/la patient-e peut s’exprimer librement, trouver des réponses à ses questions, le reconnaître dans le traumatisme qu’iel vit ou qu’iel a subi et par-dessus tout participer activement à sa propre reconstruction semblent des aspects a fortiori complètement absents dans la prise en charge actuelle des soins psychiques et psychiatrique et qui nécessitent, selon moi, un autre espace que le tri arbitraire des urgences pour être communiqué.
Mon intention en partageant ce témoignage n’est pas de dénigrer les professionnels, dont l’engagement est précieux, mais d’ouvrir un espace de réflexion sur les pratiques et sur la place des patient-e-s dans leur propre parcours de soin.
Je reste convaincue que c’est dans le dialogue, le respect mutuel et l’intégration des différentes dimensions de la vie humaine (individuelle, relationnelle, familiale, sociale) que peut se construire une approche réellement thérapeutique et émancipatrice. Une autre pierre à l’édifice afin d’encourager la mise en place du projet communautaire de médecine intégrative ?
Une invitation à repenser le soin comme espace de dialogue plutôt que de contrôle, d’écoute plutôt que de simple prescription.